Kenji Misumi
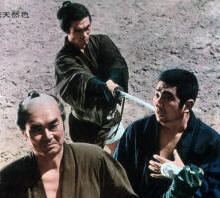
Date de naissance : Né le 2 mars 1921
Lieu de naissance : Kyoto, Japon
Fonction : Scénariste et réalisateur
Décès : 24 septembre 1975
Flash : Kenji Misumi naît à Kyoto en 1921 d’une liaison adultère entre Fukujiro Misumi, homme d’affaires important de Kobe, et “Shizu”, geisha de Pontocho, célèbre quartier des plaisirs à Kyoto. Très vite, la mère du jeune Kenji renonce à s’en occuper et le confie à sa sœur, Shika, qui travaille dans une auberge du quartier voisin. Ayant pignon sur rue (sa société de commerce maritime, la Misumi Shoji, avait bien profité de l’essor local), Fukujiro Misumi ne reconnut jamais sa paternité, mais il fit pourtant le nécessaire financier, afin que son fils profite d’une enfance sans encombre, partagée entre les bancs de l’école et les cuisines où il aidait quotidiennement sa mère adoptive. Son père l’inscrit plus tard au lycée supérieur de commerce Ritsumeikan à Kyoto, avec dans l’idée d’en faire un “businessman” comme lui. Mais Kenji se passionne pour les héros de films de sabre (Denjiro Okouchi, Tsumasaburo Bando), la littérature moderne et la peinture. Arrivé en dernière année de lycée, il écrit à son père qu’il veut devenir artiste, mais se heurte à l’intransigeance de ce dernier qui finit par lui couper les vivres. Pour qui connaît un peu sa future œuvre de cinéaste, les ressemblances entre la jeunesse de Kenji Misumi et le parcours de ses personnages est frappante : il mettra souvent en scène des héros tragiques à la paternité inavouable et à l’enfance difficile : c’est le thème central de la Trilogie du sabre, mais aussi de certains épisodes de Zatoïchi (Voyage meurtrier, Route sanglante, Voyage en enfer) et la série Baby Cart.
Une rencontre décisive
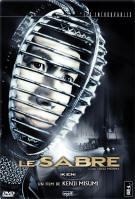
En 1939, Kenji sert au restaurant lorsqu’il entame une conversation avec un homme cultivé et passionné comme lui de cinéma. Ce client bavard n’est autre que Kan Kikuchi, le pape de l’édition moderne japonaise, équivalent d’un Jacques Rivière ou d’un Jean Paulhan (de la Nouvelle Revue française). Le jeune homme confie qu’il voudrait être réalisateur, mais Kenji Kikuchi, séduit par son érudition, lui conseille plutôt de devenir acteur, histoire de rehausser le niveau des comédiens de l’époque, jugés par lui comme un ramassis d’incultes. L’éditeur glisse dans la poche de Kenji Misumi l’adresse d’un cadre supérieur des studios de la Nikkatsu à Kyoto. Deux ans plus tard, une fois ses études terminées, Kenji Misumi n’écoutant que son courage se rend à la Nikkatsu. Hélas, il découvre que la personne mentionnée sur sa recommandation n’y travaille plus. Mais, nouveau coup de théâtre, le simple fait d’être cautionné par le fameux Kikuchi suffit à le faire embaucher dans les studios prestigieux du quartier Uzumasa, surnommé le “Hollywood japonais”. Il faut dire que l’emploi est facilité par la pénurie de main-d’œuvre, conséquence de la guerre sino-japonaise et des mobilisations de masse. Oubliant le conseil de son “ange gardien”, il préfère l’emploi d’assistant réalisateur, ce qui revient à rendre tous les menus services réclamés par les réalisateurs les plus prestigieux de cet âge d’or du cinéma japonais : Hiroshi Inagaki, Sadatsugu Matsuda, Mansaku Itami, Tomiyasu Ikeda, etc. Grâce à eux, Kenji Misumi baigne dans l’univers du film de sabre et d’époque, qui deviendra beaucoup plus tard sa spécialité. Kenji Misumi consacre le temps libre qui lui reste à se cultiver dans tous les arts. Mais en 1942, depuis l’entrée en guerre du Japon contre les Etats-Unis, la situation des studios se dégrade. La pénurie de matière première oblige la production à regrouper ses dizaines de petits studios en trois grands pôles : Toho, Shochiku, Daiei. On passe de plus de 500 films par an à moins d’une centaine. De même, les temps d’exploitation des films sont limités à 2,5 heures pas jour.
La mobilisation
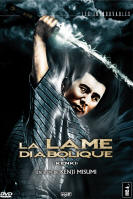
En 1942, Misumi est mobilisé, un an et demi après ses débuts dans le cinéma. La veille de son départ, une femme d’une quarantaine d’années se rend à la caserne pour lui souhaiter bonne chance. Il ne la reconnaît d’abord pas, puis comprend que c’est sa mère, qu’il n’a jamais vue. En effet, bien qu’elle vécût en face de chez lui, de l’autre côté de la rivière, sa famille adoptive lui avait toujours interdit de lui rendre visite… L’année suivante, il est envoyé sur le front de Mandchourie. Après la capitulation du Japon en août 1945, il est fait prisonnier par l’armée soviétique et envoyé dans un camp en Sibérie. Il ne rentre chez lui qu’en octobre 1948, après plus de six ans d’absence. A son retour, ses proches le découvrent transformé, mutique, visiblement marqué par une expérience dont il ne livre jamais rien. Tout juste sait-on qu’il dut effectuer des travaux forcés alors que la famine sévissait. Certains de ses ex-camarades ont témoigné avoir, avec lui, enterré ses camarades vaincus par la dureté de l’hiver sibérien. Comme pour Tomu Uchida (Le mont Fujiet la lance ensanglantée, Meurtre à Yoshiwara, Le détroit de la faim, etc.), cette partie de sa vie restera toujours un secret bien gardé. Mais une autre difficulté se présente à lui : le Japon qu’il connaissait s’est métamorphosé, et il peine à y trouver sa place.
Il est alors plus que jamais convaincu que seul le cinéma peut l’aider à reprendre goût à la vie. La société Daiei, née pendant la guerre du regroupement de plusieurs studios est devenue un des grands pôles de la production cinématographique japonaise. Fondée en 1942 par la fusion des sociétés Nikkatsu, Daito et Shinko Kinema, Masaïchi Nagata en est le président depuis 1946 (et jusqu’à la faillite de la Daiei en 1971. Grâce à un piston, il obtient un entretien avec cette future légende du 7ème art, dont les méthodes retorses sont déjà très au point : il le plaint de ses mésaventures sibériennes avant de lui demander brutalement ce qu’il veut faire à la Daiei. Déstabilisé, Kenji Misumi se souvient des conseils de Kan Kikuchi et répond qu’il veut devenir acteur. Mais Nagata ne lui trouve pas le physique de l’emploi. Au lieu de cela, il lui propose un poste d’assistant réalisateur, car il connaît son passé à la Nikkatsu où il était entré grâce à la recommandation de Kan Kikuchi, lequel a pendant la guerre occupé le poste de Nagata, à la grande surprise de Kenji Misumi…
Retour au cinéma

Misumi est taciturne et effacé. Contrairement à ses collègues de plateau, toujours enclins à s’encanailler dans les quartiers de plaisirs de Kyoto, il ne boit pas et ne fait jamais la fête. Ses seuls plaisirs : voir des films et boire du café. On murmure qu’il est un peu fou, mais lui s’installe dans cette existence de loup solitaire, et refuse même de parler de son expérience de la guerre aux forces d’occupation américaine, quand celles-ci chercheront à savoir s’il n’aurait pas subi un endoctrinement de la part des services secrets soviétiques : c’est l’époque de la guerre froide et de la “chasse aux sorcières”, comme à Hollywood. Silencieusement et méthodiquement, Kenji Misumi continue d’apprendre le cinéma en observant les metteurs en scène au travail. Il devient un véritable autodidacte, conscient que personne ne lui enseignera le métier. Il devient l’assistant exclusif (fait rare à l’époque) de Teinosuke Kinugasa, dont il avait déjà admiré dans sa jeunesse les œuvres avant-gardistes : Une page folle [kurutta ippeji], 1926, avec un scénario de Yasunari Kawabata ; Carrefour [jujiro], 1928, que Kinugasa ira montrer en Occident. Elles lui firent prendre conscience que les cinéastes japonais pouvait se hisser au niveau des expressionnistes allemands.
A cette époque, Kenji Misumi travaille essentiellement à la conception des story board grâce à ses talents de dessinateur, et au montage des bandes-annonces. Le montage était pour lui une question essentielle, l’assistant réalisateur ne pouvant être affecté au scénario selon le règlement de la Daiei. Dans le même temps, il participe aux grandes réussites commerciales et artistiques de son maître, dont L’illumination du Grand Bouddha [Daibutsu kaigen], histoire d’amour et de trahison à l’époque de Nara, sur fond de construction du Grand Bouddha au temple Todaiji. Puis il travaille sur La porte de l’enfer [Jigokumon], Grand prix (ancienne Palme d’or) à Cannes en 1954. Ce film, semi-échec au Japon, sera un succès phénoménal à New York, entre autres. Il rencontrera enfin le succès dans l’archipel après sa carrière occidentale. Kinugasa est fier du travail de son assistant et lui annonce qu’il est temps qu’il passe à la réalisation : grâce à son influence auprès de Nagata (à l’instar de Mizoguchi), il lui recommande son poulain. En octobre 1954, à 33 ans, Kenji Misumi accède au poste de réalisateur.
Les premières armes
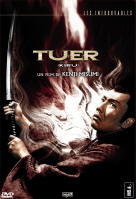
Son premier film en tant que réalisateur préfigure la suite de sa carrière, essentiellement placée sous le signe des séries à rallonge. Il est en effet chargé de tourner une énième version de Sazen Tange, le pot d’un million de pièces d’or. Plus précisément, il s’agit du dernier épisode d’une trilogie entamée par la Daiei, avec la vedette Denjirô Okouchi. En dépit du dédain de la presse pour laquelle ces histoires réchauffées n’offrent aucun intérêt, le public répond présent et gratifie Misumi d’un honnête succès en salle, juste derrière Le navire clandestin, avec Toshiro Mifune et réalisé par Toshio Sugié. Misumi gagne la confiance de ses patrons, mais apprend aussi à se fier au public, dont il devine le goût indémodable pour les films de sabre, plutôt qu’aux journalistes.
Le rythme est lancé, et, dès l’année suivante, en 1955, Kenji Misumi réalise trois films, dont deux avec Shintaro Katsu qui vient d’entrer à la Daiei, mais les films ne marchent pas bien en raison du manque de popularité de l’acteur, mal à l’aise dans les rôles de fringant samouraï ou de jeune premier. En revanche, il réussit à mettre en vedette Raizo Ichikawa, concurrent de Katsu, dans Le corbeau Taro Asa qui parvient à concurrencer La rue de la honte de Mizoguchi, sortie la même année (1956).
Certains projets déplaisent à Kenji Misumi mais il s’exécute en bon faiseur salarié. Malgré les contraintes, il en profite pour expérimenter des formes qui aboutiront à l’étonnant montage de Tuer ! [Kiru]. Le sachant mal payé, un ami scénariste lui propose de travailler à la Toei, nettement plus généreuse et respectueuse des valeurs de chacun. Mais il refuse, de peur d’être trop dépaysé dans une usine à films. L’ambiance artisanale des studios de la Daiei lui convient mieux et lui permet de poursuivre ses recherches de style à sa guise.
Le Sauveur de la Daiei

En 1961, Kenji Misumi a déjà sept années de réalisation derrière lui et 25 films. Avec l’expérience, s’affirme un style personnel qui culminera avec La Trilogie du sabre. Outre un sens aigu de l’esthétique, il attache une importance fondamentale aux décors et aux costumes, par souci de vérité, ce qui lui donne des traits en commun avec Mizoguchi. Nagata lui fait de plus en plus confiance et va même jusqu’à lui confier la réalisation d’un projet qui l’obsède depuis qu’il a vu Ben Hur : réaliser La vie de Bouddha [Shaka], qui serait le 1er film japonais en 70mm. Le geste de Nagata est d’autant plus surprenant que cette superproduction mettrait en péril la Daiei en cas d’échec commercial, la société n’arrivant pas à rentabiliser son réseau de distribution moins étoffé que ceux de la concurrence et qui nécessite donc de produire toujours plus. Mais Shaka est un carton et bat la même semaine Les canons de Navarone. C’est la plus grosse recette de l’année : Kenji Misumi sauve littéralement la Daiei de la faillite.
Avec La légende de Zatoïchi, le masseur aveugle, Kenji Misumi rend Nagata toujours plus riche. Incontestablement, ce succès est dû à la sensibilité très personnelle avec laquelle il traite ses personnages, en parvenant à les inscrire dans un cahier des charges contraignant mais qu’il ne remet jamais en cause. Cette attitude docile le coupe complètement des auteurs indépendants qui œuvrent dans la résistance aux conventions. Kenji Misumi, sorte de force tranquille, est convaincu que politique de studio et vision personnelle peuvent faire bon ménage, malgré le tyrannique Nagata qui manipule ses employés comme des pions, dans le seul but d’apporter toujours plus de nouveauté. Après la faillite de la Daiei en 1971, c’est ce même esprit artisanal qui lui permettra de rebondir à la télévision, où il apportera indéniablement un sens cinématographique inédit dans ce média. Surtout, il pourra conclure sa carrière, et sa vie, en beauté sous l’égide de Shintaro Katsu devenu entre-temps producteur. Ce dernier lui confiera encore quelques Zatoïchi (Le shogun de l’Ombre) avant de le mettre aux commandes de son œuvre la plus populaire en Occident : Baby Cart. C’est sur cette saga sombre, désespérée et barbare qu’il conclura une carrière sans frasques personnelles mais auréolée d’un souci constant de se surpasser.
Filmographie :
Zatôichi monogatari -Zatoïchi: Le Masseur aveugle (série télévisée) : 1974
Derniers samouraïs : 1974
Hissatsu shiokinin (série télévisée) : 1973
Oshi samurai – Baby cart (série télévisée) : 1973
Kozure Ôkami: Shinikazeni mukau ubaguruma – Baby cart : 1972
Kozure Ôkami: Sanzu no kawa no ubaguruma – Baby cart : 1972
Kozure Ôkami: Kowokashi udekashi tsukamatsuru – Baby cart et le sabre de la vengeance : 1972
Goyôkiba – Hanzo The Razor : le sabre de la justice : 1972
Kitsune no kureta akanbô : 1971
Shin onna tobakushi tsubogurehada : 1971
Zatôichi abare-himatsuri : 1970
Shirikurae Magoichi – Le Magoichi : 1969
Oni no sumu yakata : 1969
Zatôichi kenka-daiko – Zatoïchi: Les Tambours de la Colère : 1968
Nihiki no yojimbo : 1968
Tomuraishi tachi : 1968
Zatoichi chikemuri kaido – Zatoïchi: La Route Sanglante : 1967
Namida gawa : 1967
Yuki no mosho : 1967
Nemuri Kyoshiro 8 : Burai-ken:1966
Daimajin ikaru : 1966
Shojo ga mita : 1966
Zatoichi Jigoku tabi – Zatoïchi: Voyage en enfer : 1965
Ken ki – L’épée du diable : 1965
Muhomatsu no issho : 1965
Nemuri Kyoshiro 5 : Enjo-ken : 1965
Zatôichi kesshô-tabi – Zatoichi n°8 : 1964
Ken : 1964
Nemuri Kyoshiro 2 : Shôbu : 1964
Nyokei kazoku : 1963
Shinsengumi : 1963
Kyojin okuma shigenobu : 1963
Kiru – Tuer : 1962
Zatôichi monogatari – Zatoichi n°8 : 1962
Onnakeizu : 1962
Shaka – Bouddha : 1961
Daibosatsu toge : Ryujin no maki : 1960
Daibosatsu tôge : 1960
Shirokoya komako : 1960
Sen-hime goten : 1960
Yotsuya kaidan : 1959
Senbazuru hicho : 1959
Kagero-gasa : 1959
Kaibyô noroi no kabe : 1958
Momotaro zamurai : 1957
Asa Tarô garasu : 1956
Source : Dossier de presse du film « Wild Side Vidéo ». Denis Brusseaux et Fabrice Arduini.
Ken – Misumi Kenji no yôen naru eizôbi [Le sabre – l’esthétique envoûtante de Kenji Misumi, Kazuma Nozawa, Editions Yotsuya Round, 1998.
Le Japon et l’éthique samouraï [Hagakuré nyumon], Yukio Mishima,
traduit par Emile Jean, Arcades Gallimard, 1985.
Histoire de la littérature populaire japonaise. Faits et perspectives (1900-1980), Cécile Sakai, Editions L’Harmattan, 1987.
Martyre précédé de Ken, Yukio Mishima, Editions Folio, Gallimard.

Commentaires récents